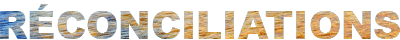travail - 18 février 2017
Bac blanc philo - Explication de texte : MARX, Le Capital, 1867
Bac blanc philo - Explication de texte : MARX, Le Capital, 1867
Ethologie
Bribe
travail
Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature.
Tout vivant est en permanence en quête de ressources de vie. Les humains sont des vivants animaux sociaux, cette quête se fait de manière collective. C'est cela que l'on appelle travail. Sans ressources de vie, un vivant disparaît
L'homme y joue lui-même vis à vis de la nature le rôle d'une puissance naturelle.
Cela est vrai de tous les vivants.
Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement, afin de s'assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa vie.
L'humain est un animal qui possèdent des mains-outils. C'est la principale différence qui en fait sa spécificité. Tous les vivants considèrent toutes les espèces autres qu'elles mêmes comme des ressources de vie.
En même temps qu'il agit par ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature, et développe les facultés qui y sommeillent.
C'est également vrai pour tous les vivants.
Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail où il n'a pas encore dépouillé son mode purement instinctif.
L'instinct est une notion spéciste qui définit l'homme comme transcendant à tous les autres vivants. C'est une notion non scientifique.
Notre point de départ c'est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme.
L'humain étant le seul à posséder des mains, il possède sa manière spécifique d'être en quête de ses ressources de vie. Tous les vivants ont leur manière spécifique pour y parvenir: ce sont les mieux adaptés qui l'emportent.
Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habilité de plus d'un architecte.
L'araignée et l'abeille sont minuscules. Comme les humains, elles sont en quête permanentes de ressources de vie. Les tisserands et les architectes sont des humains. Pour les comparer aux insectes, il faut une théorie générale de la quête des ressources de vie qui prennent les millions d'espèces vivantes qui existent et non des exemples aussi ténus.
Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche.
Affirmation spéciste: l'humain n'est pas transcendant par rapport à l'abeille. L'abeille possède également un cerveau comme tous les animaux qui sont hétérotrophes et qui sont obligés d'être mobiles - à l'inverse des végétaux - pour trouver leur ressources de vie. L'abeille possède un cerveau adapté à ses besoins comme l'humain, de son côté. Pour l'humain, le cerveau de l'abeille est trop petit et pour l'abeille celui de l'humain trop énorme.
Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action, et auquel il doit subordonner sa volonté."
Il faut généralisé cette déclaration à tous les animaux.
"Le résultat auquel la quête de ressources de vie aboutit préexiste idéalement dans l'imagination de l'abeille et de l'araignée. Ce n'est pas qu'elles opèrent seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; elles y réalisent du même coup leur propre but dont elles ont conscience, qui détermine comme loi leur mode d'action, et auquel elles doivent subordonner leur volonté"
Conclusion
Les humains sont une espèce animale et il y a, dit-on, environ 10 millions d'espèces animales.
copyright GS - 18 février 2017